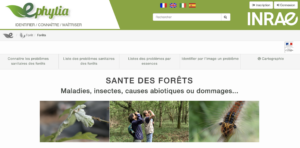Transplantation et santé de la forêt
Vite Plus d’Arbres transplante des jeunes plants d’arbres d’endroits où ils sont indésirables ou en excès pour les replanter là où ils pourront grandir. Tout comme les êtres humains, les arbres peuvent aussi tomber malades. Nous voulons éviter que les jeunes arbres et arbustes ne transportent des maladies avec eux sur un nouveau site, contribuant ainsi à la propagation des maladies.
Vite Plus d’Arbres prends un certain nombre de mesures pour prévenir la propagation des maladies. Nous vous demandons d’y adhérer également en tant que bénévole. Sur cette page, vous trouverez des connaissances de base sur les maladies des arbres ainsi que les descriptions des arbres courantes (chez les jeunes pousses).

Il est important de se rendre compte que la contribution de Vite Plus d’Arbres à la propagation des maladies est limitée, pour un certain nombre de raisons :
- De nombreuses maladies sont présentes partout. La maladie de l’orme et la chalarose, par exemple. Nous ne transplantons pas un orme ou un frêne malade, mais la propagation de ces maladies est déjà un fait.
- De nombreuses maladies n’apparaissent que dans les arbres plus âgés ou plus épais, et non dans les jeunes plants.
- Les bénévoles qui distribuent les arbres de la campagne sont naturellement enclins à rendre les planteurs heureux. C’est pourquoi ils ne distribuent que des plants en bonne santé. Les jeunes plants qui semblent malades finissent dans une haie sèche ou sont éliminés en accord avec le responsable du site.
Transplantation et santé de la forêt
La transplantation et les maladies des arbres
Les maladies et les parasites des arbres sont omniprésents. Ils se transmettent d’un arbre à l’autre et d’une espèce à l’autre, par l’intermédiaire de champignons ou de bactéries présents dans le sol, par les animaux de la forêt ou par l’air.
La biodiversité : le système immunitaire de la nature
La plupart des maladies se propagent donc rapidement, surtout dans les forêts monotones. L’élimination totale des maladies n’est pas réaliste, c’est pourquoi la chose la plus importante pour avoir un bon système immunitaire dans la forêt est la biodiversité.
Biodiverse = en bonne santé
La chalarose, qui cause le flêtrissement des frênes est présente en Europe. On s’attend à ce que 90 % des frênes en décèdent. Nous ne voulons pas que cette maladie se propage davantage. Pour aller à son encontre, nous pouvons contribuer au processus de sélection de spécimens présentant une bonne résistance. Une nouvelle population peut se développer à partir de ces spécimens.
En transplantant des arbres sains, nous contribuons à la diversité du matériel génétique ; vous plantez des arbres qui ont poussé à partir de graines différentes. Les arbres sains produisent plus de graines que les arbres malades, les semis ont donc des parents relativement résistants aux maladies. C’est à nous de veiller à ce qu’une grande diversité d’espèces soit distribuée !
Une grande attention pour les racines
Limitez les dégats aux racines
Plus les racines sont intactes, plus l’arbre est fort. Il faut donc transplanter en abîmant le moins possible les racines. Lorsque vous mettez la pelle dans le sol, il est toutefois impossible de voir comment les racines se déplacent. Néanmoins, l’objectif est de limiter les dégâts. Pour ce faire, vous pouvez tracer un cercle (de la taille d’un pied) autour de la base du plant pour décoller la terre. Utilisez ensuite l’astuce du levier pour extraire le jeune arbre. Une fois que l’arbre s’est suffisamment détaché, vous pouvez tirer l’arbrisseau et le secouer pour le dégager du sol. Rebouchez ensuite le trou.

Transplantation en racines nues
La transplantation avec des racines nues permet d’éviter que des maladies ne se propagent accidentellement dans le sol. Secouez donc bien votre plant ! La plantation sans motte est également moins lourde, ce qui est intéressant pour le transport, l’étiquetage et la mise en jauge. Veillez à protéger les racines, par exemple en les recouvrant d’une serviette humide ou d’un sac de jute.

évitez une plantation monotone
En évitant les plantations monotones, vous réduisez la propagation des maladies et rendre l’écosystème plus sain. La plantation non monotone est synonyme de diversité des espèces et du matériel génétique. Dans la nature, la sélection naturelle est permanente : sur des millions de graines ou d’individus (selon l’espèce), seules quelques dizaines atteignent l’âge de la reproduction. Grâce aux croisements, il existe des millions de traits, de gènes et de variations d’une espèce originale. Ces variations sont le résultats d’une sélection naturelle.

La prévention de la propagation des maladies
Pour éviter la propagation des maladies, la première étape consiste à créer un plan de récolte avec le/la propriétaire du site de récolte. Celui-ci connaît le mieux le terrain et sait quelles maladies ont été repérées à quel endroit. Bien informé, vous pourrez ensuite décider où récolter et où ne pas récolter.
La reconnaissance des maladies
Malgré les bons soins apportés, il peut arriver que vous tombiez sur quelque chose dont même le propriétaire n’avait pas connaissance. Si vous tombez sur un jeune arbre malade, ne le prenez pas. Parfois, cela signifie qu’il est préférable de ne pas récolter du tout près des arbres où vous avez trouvé la maladie. Cela dépendra de la maladie et de l’espèce.
Check de santé
vérifiez l’arbre mère
Tout d’abord, identifiez l’arbre mère dans la zone de récolte. La plupart des maladies qui ne sont pas (encore) visibles sur un plant sont présentes sur l’arbre mère. L’arbre mère est l’arbre mature proche du plant. Si vous pouvez identifier sur elle l’une des maladies décrites dans ce guide, il y a de fortes chances que les semis soient également infectés..
vérifiez la couleur
Soyez attentif lorsqu’un plant se décolore brusquement. Dans le cas de la chalarose, par exemple, l’écorce de la pousse du frêne passe du gris au jaune ou au blanc.
vérifiez les sommets
Des bourgeons secs indiquent que la pousse d’arbre n’est pas en bonne santé. Si un plant produit encore des feuilles sur le côté, il s’agit d’une floraison d’urgence. Le plant ne se porte pas bien, mais il essaie de survivre.
comparez avec d’autres exemplaires
Quand le plant diffère de ses congénères, il s’agit d’un possible signe de maladie.
Comment procéder
N’emportez jamais un plant malade, mais consultez le gestionnaire du site et/ou du centre d’accueil d’arbre pour déterminer la meilleure marche à suivre. Vous pouvez laisser le plant malade ou l’enlever et vous en débarrasser.
En cas de doute
Vous n’êtes toujours pas sûr si un plant est malade ou non? Dans ce cas, séparez ces jeunes plants des autres, mettez-les en pot dans un endroit différent. Prenez une photo et envoyez-la par courriel à info@viteplusdarbres.fr, ou alors dans nos groupes WhatsApp ou Signal. Nous demanderons l’avis de nos écologistes.
Les maladies les plus fréquentes
Nous avons créé un inventaire des maladies que nous rencontrons le plus souvent.
Chancre bactérien du marronnier
Le chancre bactérien du marronnier est une maladie du marronnier d’Inde, causée par une bactérie qui bloque les cellules responsables du transport des aliments. Des taches brun rouille et humides se développent sur l’écorce et les branches, qui s’étendent sur le reste du tronc. Du liquide s’écoule de ces endroits : l’arbre « saigne ». Le liquide de cette tache est clair au début, puis change de couleur pour devenir brun foncé puis sirupeux
Sur un arbre mature, cela ressemble à ceci :
Sur une pousse d’arbre, cela ressemble à ceci :

Dans la nature, la maladie est principalement observée sur les arbres matures. Lorsque vous allez récolter des marronniers d’Inde, il est judicieux de vérifier l’arbre mère pour détecter d’éventuelles taches. Si vous êtes confronté au chancre bactérien du marronnier, il est conseillé de ne pas récolter les marronniers d’Inde à cet endroit.
La transplantation de plants sains de marronnier d’Inde peut également être positive. Il existe des grandes différences dans la résistance entre les marronniers d’Inde. Les semis d’apparence saine peuvent être résistants et la propagation de ce matériel de plantation contribue au développement d’une population résistante présentant une grande variation dans les caractéristiques héréditaires et écologiques.
Parcontre, comme on ne peut pas être certain que ces jeunes plants sauvages ne sont pas malades, et si cela est toujours visible à un si jeune âge. Par conséquent, à moins que vous ne soyez vous-même écologiste, il est sage de ne pas récolter de semis à proximité d’un arbre mère malade. Toutes les taches que vous trouvez sur l’arbre mère ou le semis peuvent être photographiées et envoyées au responsable du terrain afin qu’il en soit également informé.
Reconnaître le maronnier d’Inde
Le marronnier d’Inde se reconnaît au gros bourgeon au sommet de la pousse : celui-ci est gros, brun et collant, et présente des cicatrices foliaires en forme de grand fer à cheval. Voir aussi la carte des bourgeons.
La feuille du marronnier d’Inde est une feuille composée en forme de main. Les marrons sont ronds et lisses et leur enveloppe a des épines. Elles sont beaucoup moins dures et acérées que les épines d’un châtaignier.
Des taches brunes sur les feuilles ?
Des taches brunes sur les feuilles du marronnier d’Inde, parfois en masse, peuvent donner à l’arbre un aspect malade. Cependant, il ne s’agit pas du chancre bactérien. Les taches brunes sont causées par les chenilles d’un minuscule papillon, la mineuse du marronnier. Habituellement, cela ne pose pas de problème pour l’arbre, mais cela peut le rendre plus faible et plus vulnérable à toutes sortes de champignons.
Le feu bactérien (aubépine/sorbier)
Le feu bactérien est une maladie qui peut toucher les arbres fruitiers, le sorbier et l’aubépine. Cette maladie est causée par une bactérie qui provoque le flétrissement, le dessèchement, et la décoloration des fleurs, des pousses, des feuilles et des rameaux. Lorsque l’on coupe l’écorce, on observe une décoloration brun-rougeâtre avec des tissus humides et collants. Des chancres apparaissent sur le tronc et les branches épaisses, avec des gouttelettes de mucus sur les bords qui passent du blanc laiteux au brun jaunâtre.
Cela ressemble à ceci sur les arbres :
Cette maladie est principalement visible sur les arbres matures. Pour transplanter en toute sécurité des pousses de ces espèces, il convient donc de vérifier que l’arbre mère ne présente pas de décoloration ou de flétrissement. Il est peu probable de trouver des plants infectés indépendamment. La maladie se propage par les oiseaux et les insectes qui volent d’un arbre à l’autre, ou par les personnes qui touchent l’arbre malade avec leurs mains ou leurs outils et le transmettent ensuite. Dans des cas plus rares, le vent et la pluie peuvent aussi transmettre la maladie. Étant donné que les pousses ne portent pas encore de fruits ou de fleurs, il est peu probable que des personnes, des oiseaux ou des insectes transmettent la maladie à un semis. Si l’arbre mère présente des signes de maladie, il est conseillé de ne pas transplanter les semis de ces espèces. Signalez l’arbre mère malade au gestionnaire du site.
Le gouvernement a désigné des zones tampons : des zones exemptes de cette maladie et protégées par une obligation de contrôle. Dans ces zones, il est interdit de planter des espèces sensibles au feu bactérien (comme l’aubépine). Voir aussi les informations sur les zones tampons au Pays de la Loire par exemple.
Reconnaître l’aubépine et le sorbier
Les sorbiers ont des bourgeons feutrés et poilus ; le bourgeon terminal se trouve souvent sur les feuilles courtes. L’aubépine a un petit bourgeon émoussé et étalé. Les épines se trouvent à côté du bourgeon et l’aubépine possède des épines de branche.
La graphiose de l’orme ou maladie hollandaise (orme)
La graphiose de l’orme touche toutes les espèces d’orme et est causée par des champignons. Il s’agit d’une maladie courante en Europe. Les champignons provoquent l’obstruction des vaisseaux du bois de l’orme et la mort de l’arbre. La propagation de la maladie de l’orme est due au grand scolyte de l’orme qui propage le champignon. Ce coléoptère se reproduit dans le bois mort ou affaibli de l’orme. Les œufs donnent naissance aux larves et les larves donnent naissance aux jeunes coléoptères. Ils s’envolent et infectent les ormes sains. Les ormes peuvent également être infectés par contact avec les racines d’un arbre voisin malade. Dans une rangée d’arbres, un ou plusieurs arbres meurent ainsi chaque année.
Le premier signe de la maladie est la présence de feuilles flétries (d’abord jaunes, puis brunes) sur certaines branches, souvent sur la branche située au sommet de la couronne. Les feuilles mortes restent d’abord attachées aux branches. La couronne prend alors une teinte brune. Elles tombent ensuite en masse. Les branches atteintes meurent rapidement. Une coupe transversale des branches montre des points de couleur foncée dans le cerne extérieur. Des couloirs en forme d’éventail sont visibles sous l’écorce, à la surface du bois. Ces couloirs sont formés par le grand scolyte de l’orme.

Sur les jeunes plants, la maladie hollandaise de l’orme n’est souvent pas visible en hiver. Si un plant a des feuilles flétries, cela ne signifie pas qu’il est malade. La maladie de l’orme transmise par un coléoptère n’est pas dangereuse pour un jeune plant. Les ormes dont le diamètre du tronc est inférieur à cinq centimètres ne conviennent pas à la reproduction de l’insecte et ne représentent donc pas un grand danger, malgré la présence du champignon. Les semis d’orme solitaires ne sont donc pas malades.
La maladie de l’orme, propagée par le champignon, peut toutefois constituer un danger. Il faut donc toujours examiner l’arbre mère, qui peut révéler la maladie. Si l’arbre mère est malade, ne récoltez pas de jeunes plants d’orme dans cette zone. Il est plus sage de récolter dans une autre parcelle.
Reconnaître l’Orme
Reconnaissable à son bourgeon : le bourgeon est brun et plutôt pointu, le bourgeon floral est sphérique. Voir aussi le tableau des bourgeons. Feuille : base rugueuse et oblique, ovale, asymétrique, doublement dentée, glabre sur le dessus, légèrement poilue en dessous et se terminant en pointe.
La chalarose (frêne)
La chalarose est un champignon originaire d’Asie que l’on retrouve aujourd’hui sur les frênes dans toute l’Europe. Le champignon commence dans la feuille, puis attaque l’écorce par le pétiole et les rameaux. L’interruption de la circulation de la sève entraîne le dépérissement de la feuille et de la tige au sommet de l’arbre. Ce phénomène est également visible sur les semis en hiver. La mortalité des branches de frêne est reconnaissable à la forte décoloration de l’écorce au sommet du semis. Le gris vire au jaune, presque au blanc. Dans les grands arbres, une décoloration brune est visible sur les rameaux mourants. La mortalité des branches de frêne n’est pas toujours fatale pour l’arbre ; la guérison est possible.
Les rameaux des frênes un peu plus âgés deviennent bruns plutôt que gris, comme le montre la photo ci-dessous.
Les semis prennent une couleur jaune-blanc au sommet. La deuxième image montre très clairement comment le sommet blanc-jaune d’un plant malade contraste fortement avec les frênes sains.
Le champignon forme de petits champignons blancs sur les pétioles tombés des arbres infectés entre juin et septembre. Ces champignons produisent un grand nombre de spores qui peuvent être disséminées sur de longues distances par le vent. De nouvelles infections se développent dû à ces spores sur les feuilles d’arbres encore sains, après quoi le cycle recommence. En outre, la maladie peut également être propagée par des plantes infectées qui ne présentent pas encore de symptômes.
Ne transplantez pas les frênes qui présentent des symptômes de la maladie. Vous pouvez également choisir de ne pas récolter de frênes dans la parcelle où la maladie a été détectée. Toutefois, la transplantation de jeunes plants sains trouvés dans la parcelle peut également être positive. Les jeunes plants proviennent généralement d’arbres sains. En effet, plus il y a de branches malades, moins l’arbre produit de pollen et de graines. Les jeunes plants sont porteurs d’un matériel génétique potentiellement important qui les rend résistants. Vite Plus d’Arbres peut donc apporter une contribution importante à un futur stock de frênes génétiquement diversifiés et résistants.
Reconnaître le Frêne
Les bourgeons du frêne sont remarquables : ils sont noirs et se font face. Les feuilles sont pennées et se font face. Sur la face inférieure, elles sont velues le long de la nervure centrale.
Maladie du hêtre (hêtre)
Phytophthora syringea, également connue sous le nom de maladie du hêtre, est une infection fongique de l’écorce du hêtre. Occasionnellement, le champignon est également présent sur les variétés de poiriers et de pommiers. Le champignon forme des taches noires sur le tronc et se propage par les oiseaux et les insectes ou par voie aérienne. Il ne s’agit pas d’une maladie dangereuse, car les arbres qui en sont atteints restent vivants et repoussent chaque année. Cependant, la vitalité de l’arbre semble diminuer.
Sur une pousse d’arbre, cela se présente comme suit :

De plus, les taches noires sont quelque peu visqueuses. Ne pas transplanter les semis présentant des symptômes de maladie, signaler la maladie au responsable du site.
Reconnaître le hêtre
Reconnaissance par le bourgeon : les bourgeons sont bruns, allongés et pointus. Les bourgeons se distancent de la branche et sont dispersés. La feuille est ovale et son bord est net et légèrement ondulé.
Coloration bactérienne du saule (saule)
La coloration bactérienne du suale (Brenneria salicis) est dû à une bactérie qui obstrue et tue les vaisseaux du bois des espèces de saules. Les saules qui ont une forme d’arbre plutôt qu’un arbuste sont particulièrement touchés. Le saule des vanniers est particulièrement touché. Les feuilles (étalées sur la couronne) se fanent et sèchent, mais restent généralement sur l’arbre. À un stade ultérieur, les branches sont aqueuses et transparentes lorsqu’elles sont coupées (comme un filigrane), l’humidité suinte et une décoloration brune rapide (dans les branches de plus de cinq ans). Au début, l’arbre produit beaucoup de pousses verticales à l’intérieur de la couronne, mais l’arbre finit par mourir après quelques années. La maladie se propage parce que les arbres malades se décomposent et ne sont pas éliminés, ce qui fait que les arbres qui poussent ensuite à cet endroit attrapent à nouveau la maladie. Les arbres malades finissent par mourir, après que suffisamment de branches se soient décomposées.
Sur un saule mature, cela se présente comme suit :

Cette maladie ne se produit pas chez les semis. Les saules avec racines peuvent toujours être transplantés. Cependant, nous coupons aussi souvent des branches de saule. Nous émondons les saules et utilisons les fentes pour permettre à de nouveaux arbres de pousser. Alors ne prenez pas de boutures sur un arbre malade ! En cas de doute, ne taillez pas le saule, ni les saules qui se trouvent juste à côté. Si un arbre est malade, il est probable que les arbres immédiatement adjacents soient également entrés en contact avec la maladie.
Reconnaître le saule
Identification par ses bourgeons : petits bourgeons, dispersés, allongés, contigus et finement poilus. La branche est gris rosé et très flexible.
Bostryche typographe (conifères)
Le bostryche typographe est un scolyte qui survit grâce aux flux de sève d’un arbre vivant. La larve du scolyte fait d’abord un trou dans la couche externe de l’écorce et mange ensuite à travers le cambium. En dessous, les larves créent un système de couloir pendant qu’elles mangent.
On reconnaît les arbres touchés par le scolyte à la présence de farine brunâtre sur le tronc, à la coloration jaunâtre des couronnes, à la perte d’aiguilles, à l’activité des pics et à la chute de l’écorce. Ce phénomène se produit principalement sur les épicéas ou sur les arbres très affaiblis (par la sécheresse et l’humidité).
Sur un conifère mature, cela se présente comme suit :

Le bostryche typographe ne se trouve pas sur les jeunes plants. La circonférence n’est pas encore assez grande pour qu’un coléoptère puisse s’installer dans l’écorce. Cependant, les femelles ingèrent les protéines fraîches des jeunes plants juste avant de s’accoupler et de déposer leurs œufs. Le coléoptère, en plus d’être un ravageur, peut transmettre d’autres champignons provenant d’autres arbres. Il n’est pas facile de lutter contre ce phénomène. Néanmoins, vous pouvez observer lors de votre marche vers le site de récolte si vous rencontrez d’autres maladies. Vous trouvez beaucoup de maladies dans cette zone ? Dans ce cas, vous pouvez reconsidérer les jours de récolte à cet endroit.

Reconnaître l’épicéa
Les aiguilles pointues sont de couleur vert clair à jaune et mesurent entre 1,5 et 3,5 centimètres. L’épicéa a un cône de 10 à 15 centimètres. La couronne de l’épicéa commun a une forme conique drapée autour du tronc, les branches les plus jeunes poussant vers le haut dans la partie supérieure, tandis que les branches les plus âgées dans la partie inférieure s’affaissent légèrement. L’écorce est rougeâtre.
Scolyte du chêne (Chêne)
Le scolyte du chêne est un coléoptère qui vit dans l’écorce des arbres. Il se trouve principalement dans les chênes, mais aussi dans les saules, les peupliers, les ormes, les hêtres, les châtaigniers et d’autres espèces. Le coléoptère se nourrit d’un passage horizontal (mère) dans le bois d’un jeune arbre (souvent déjà affaibli) et y pond des œufs. Lorsque ces œufs éclosent, les larves se nourrissent d’un nouveau passage (perpendiculaire au passage mère) et, après la nymphose, se nourrissent elles-mêmes de l’arbre en tant que coléoptères. Un grand nombre de couloirs horizontaux coupe le flux de sève de l’arbre, ce qui entraîne la mort de l’arbre. L’infestation se produit principalement dans les jeunes arbres.
Les arbres infestés par le scolyte du chêne se reconnaissent à la présence de petits trous (1 à 2 mm) dans le bois, de bandes brun foncé ou noires dues aux champignons apportés par le scolyte, de couloirs larvaires dans le bois et de bourre/sciure sur l’écorce ou le sol.


Le scolyte du chêne n’est pas présent sur les jeunes plants. Cependant, les dommages causés par le coléoptère sur l’arbre mère peuvent affecter les semis. L’arbre mère était déjà affaibli avant l’arrivée de de l’insecte et il est une fois infesté encore plus faible. Il convient donc de vérifier soigneusement que les jeunes plants situés sous l’arbre mère ne sont pas affaiblis ou malades.

Reconnaître le chêne
Reconnaissance par le bourgeon : à l’extrémité du rameau, plusieurs bourgeons sont réunis en une grappe. Les bourgeons le long du rameau sont légèrement plus petits et alternent. Les bourgeons sont brun (foncé), ovales à ovoïdes et peuvent être (légèrement) poilus.
LA suie de l'érable (érable)
La suie de l’érable est causée par le développement sous l’écorce du champignon Crytpstroma coricale. Elle touche principalement l’érable sycomore. Elle se manifeste par le flétrissement des feuilles, des boursouflures sur le tronc et la libération de spores noires. Les arbres touchés deviennent cassants et finissent par tomber.
Elle touche principalement des arbres qui ont subis un stress auparavant. Le champignon rentre par les blessures de l’arbre. Les infections sont favorisées par un climat sec et chaud et par la rareté de l’eau. Le champignon est propagé par le vent qui emmène les spores. Elle peut entraîner la mort de l’arbre dans les trois ans après son infestation.
L’infestation par le champignon est aussi présente chez les jeunes arbres. Heureusement elle est facile à détecter. Comme les spores sont très volatiles et souvent latent dans des arbres en bonne santé. Notre conseil est de ne pas récolter d’érables sur un site de récolte ou le champignon est présent. N’oubliez pas de signaler l’infestation au propriétaire si il n’en était pas au courant !


Reconnaître l’érable sycomore :
Identification par ses bourgeons : bourgeons opposés sur la branche de couleur verte. Un grand bourgeon terminal vert sur la pointe de la branche. La branche est grisâtre avec des lenticelles blanches.